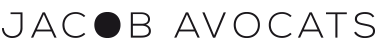Le premier décret d’application de l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif a été publié au Journal Officiel mercredi 17 septembre (Décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif). L’ordonnance et le décret entreront en vigueur le 1er octobre 2014.
Le financement participatif,ou crowdfunding, permet de financer des projets (entrepreneuriaux, artistiques, équitables etc.) en récoltant des fonds auprès d’un grand nombre de personnes, par l’intermédiaire d’une plateforme internet qui met en relation les porteurs de ces projets et des particuliers-investisseurs.
Cette pratique a connu un rapide développement en raison de sa simplicité de fonctionnement, de son aspect désintermédié (il fonctionne sans l’intervention des acteurs traditionnels du financement), et des difficultés que rencontrent certains porteurs de projets à récolter des fonds. En 2013, 80 millions d’euros ont été levés en France grâce au crowdfunding.
Le financement participatif peut revêtir différentes formes, selon la nature de la contribution :
- Le donation crowdfunding, qui fait appel à des dons avec ou sans contrepartie : La rémunération de l’investisseur est ici sans contrepartie financière : soit il n’y a pas de contrepartie du tout, soit celle-ci s’effectue en nature (un dvd, une entrée gratuite pour un spectacle, etc). Les donateurs sont alors les premiers clients de l’entrepreneur : ils achètent en prévente le produit ou la prestation objet du projet et deviennent les premiers ambassadeurs de celui-ci.
- Le credit crowdfunding qui permet l’octroi de prêts, rémunérés ou non : des particuliers prêtent des fonds, avec ou sans intérêt, à un porteur de projet. Sous cette forme, le crowdfunding vise surtout des entreprises matures et détenant déjà des fonds propres, qui seront en mesure de rembourser leurs créanciers.
- L’equity crowdfunding ou crowd-equity qui permet une prise de participation au capital de la société portant le projet. L’investisseur est alors rémunéré au moment de la distribution des dividendes ou de l’encaissement de la plus-value réalisée lors de la cession des titres souscrits. Cette forme s’adresse aux jeunes entreprises qui consentent à compter de nombreux actionnaires dans le futur, ces actionnaires ayant souvent vocation à devenir leur principal levier de communication.
Jusque récemment, en l’absence de dispositif juridique propre, ce modèle de financement se heurtait à des normes législatives et réglementaires rigides et inadaptées. Afin de favoriser le développement du financement participatif dans un environnement rassurant et sécurisé pour les contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs), une ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 a donc enfin été adoptée.
Ce texte règlemente les trois types de crowdfunding susvisés : par l’allocation de dons, par l’octroi de prêts et par la souscription de titres.
Assez logiquement, le don est le mode de financement le moins strictement régulé : les plateformes de dons peuvent, si elles le souhaitent, revêtir, sous sa forme allégée, le nouveau statut d’intermédiaire en financement participatif. Nous nous concentrerons donc sur les deux autres : les plateformes de prêts et les plateformes d’investissement en capital.
- Le nouveau cadre normatif du credit crowdfunding
- La création du statut d’intermédiaire en financement participatif
L’ordonnance du 30 mai 2014 crée un nouveau statut d’intermédiaire en financement participatif (« IFP ») pour les plateformes proposant des services de prêt à titre habituel.
La réception de fonds en faveur de tiers constitue un service de paiement. En conséquence, l’IFP doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») et est placé sous sa tutelle.
Il bénéficie d’un régime prudentiel allégé, sous réserve que le montant total des opérations de paiement qu’il réalise ne dépasse pas 3 millions d’euros par mois (ce plafond, précisé dans le décret d’application du 16 septembre, s’applique au montant total moyen pour les douze mois précédents des opérations de paiement exécutées par la plateforme).
L’ordonnance, complétée par son décret d’application, soumet également l’IFP à des règles de bonne conduite et d’organisation, à un devoir de transparence et d’information des prêteurs et des emprunteurs (notamment les mentions obligatoires des contrats types mis à disposition de ceux-ci), ainsi qu’à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les deux textes imposent également aux dirigeants des IFP des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle.
- L’assouplissement du monopole bancaire
L’ordonnance du 30 mai 2014 met fin au monopole bancaire sur les prêts rémunérés, en permettant à des particuliers (personnes physiques), agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, de consentir aux porteurs de projets (personnes physiques ou morales) des prêts rémunérés à taux fixe, à la seule condition qu’ils aient été mis en relation avec ces porteurs par le biais d’un IFP.
Les taux d’intérêts, libres sous réserve de ne pas être usuraires, peuvent a priori être fixés de différentes façons : soit directement par l’entrepreneur, soit par les internautes à l’issue d’une enchère inversée, les taux les plus bas proposés étant retenus).
Le montant de chaque prêt avec intérêt ne peut excéder 1 000 euros par projet. La durée du crédit ne doit pas excéder 7 ans. Le prêt sans intérêt ne peut, pour sa part, dépasser 4 000 euros par prêteur et par projet.
Enfin, chaque projet ne peut pas emprunter plus d’un million d’euros.
- Le nouveau cadre normatif du crowd-equity
- La création du statut de conseiller en investissements participatifs
L’ordonnance crée un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs (« CIP ») qui permet aux plateformes de bénéficier d’un agrément spécifique, délivré cette fois par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).
Les CIP seront soumis au Code Monétaire et Financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire et la lutte contre le blanchiment. Ils ont l’interdiction d’être rémunérés en titres financiers et ne peuvent recevoir d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer leur activité.
Les CIP auront l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle et d’adhérer à une association agréée par l’AMF.
L’ordonnance impose à ces CIP de se conformer à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu’elles donnent à leurs clients internautes (devoir de loyauté, de mise en garde sur les risques, obligation de fournir une information transparente sur les frais et leur rémunération notamment).
- L’introduction d’une exemption aux règles de l’appel public à l’épargne
L’ordonnance, complétée par son décret d’application, indique que l’offre de titres non cotés à des internautes par l’intermédiaire d’un CIP ne constitue pas une offre au public au sens du Code Monétaire et Financier sous réserve que son montant ne dépasse pas 1 million d’euros.
Selon toute vraisemblance, au-delà de ce plafond la levée de fonds restera possible mais tombera sous le coup de la procédure d’appel public à l’épargne et sera donc plus contraignante : l’établissement d’un prospectus sera notamment imposé.
- L’introduction de règles spécifiques applicables aux sociétés par actions simplifiées
Toutes les entreprises ne seront pas éligibles au crowd-equity.
La très grande majorité des sociétés ayant recours au crowdfunding étant constituées en sociétés par actions simplifiées, l’ordonnance a mis en place des mesures spécifiques pour les porteurs de projet constitués sous cette forme sociale qui souhaitent offrir leurs titres par le biais d’une plateforme.
En vertu de ces mesures, ces sociétés par actions simplifiées doivent respecter certaines obligations applicables aux sociétés anonymes notamment en termes de publication des comptes ou de consultation des actionnaires (droits de vote, modification des statuts, convocation des associés aux assemblées etc.). Vraisemblablement, ces règles s’appliqueront nonobstant toute clause contraire des statuts.