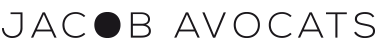En 2010, Troy HENRIKSEN, un artiste peintre américain vivant à Paris, a assigné en contrefaçon et parasitisme, une artiste peintre française, Corinne DALLE ORE (et sa galerie), qu’il avait rencontré en 2005 lors d’un salon professionnel d’art contemporain et qui avait par la suite visité son atelier.
En 2010, Troy HENRIKSEN, un artiste peintre américain vivant à Paris, a assigné en contrefaçon et parasitisme, une artiste peintre française, Corinne DALLE ORE (et sa galerie), qu’il avait rencontré en 2005 lors d’un salon professionnel d’art contemporain et qui avait par la suite visité son atelier.
Il estimait que Corinne DALLE ORE avait conçu et réalisé des œuvres reprenant les caractéristiques de 4 de ses tableaux, et avait repris les thèmes de ses séries d’œuvres : « cœurs », « portraits », « boxe » et « fruits ».
Le 2 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes de l’artiste américain en jugeant que l’artiste française avait commis des actes de contrefaçon en reprenant les caractéristiques essentielles des 4 œuvres picturales revendiquées, et avait commis des actes de parasitisme en reproduisant les caractéristiques essentielles des séries « fruits », « cœurs », « portraits », « boxe ».
L’artiste française et sa galerie d’art ont interjeté appel de ce jugement.
Le 27 février 2013, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur les caractères contrefaisant et parasitaire des œuvres de l’artiste française.
Sur la contrefaçon, la Cour rappelle, dans un premier temps, que l’appréciation de la contrefaçon s’effectue de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments, et non pas par l’examen de chacun d’eux pris individuellement.
La Cour s’est ensuite livrée à un examen précis des 4 tableaux revendiqués et des œuvres litigieuses. Ceci lui a permis d’infirmer la décision de première instance reconnaissant des actes de contrefaçons desdits tableaux de l’artiste américain aux motifs que :
– Certaines œuvres de l’artiste française ne présentent que l’un ou l’autre des éléments du premier tableau de l’artiste américain et non pas tous les éléments dans une combinaison identique à celle invoquée.
– S’agissant de deux autres tableaux revendiqués, elle considère que l’impression de proximité qui se dégage de la reprise de certains éléments préexistants ne permet pas pour autant de retenir une reproduction au sens du droit d’auteur. Ainsi, la contrefaçon, définie à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l’exploitation de l’œuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce.
– Enfin, pour le dernier tableau revendiqué, la Cour affirme que l’impression d’ensemble de l’œuvre de la défenderesse est nettement distincte et précise que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, celles-ci s’avèrent en l’espèce totalement occultées par les différences de choix arbitraires des deux artistes donnant à voir une impression globale distincte, d’univers reflétant la personnalité d’auteurs différents.
Sur le parasitisme, la Cour relève que 2 œuvres de l’artiste française s’inspirent trop largement des tableaux de l’artiste américain (fond similaire, apposition d’inscription dans un graphisme noir, etc.), et caractérisent donc des actes de parasitisme. En effet, ces œuvres sont susceptibles de générer un risque d’assimilation avec les œuvres de l’artiste américain, fruit d’un travail propre, ayant une valeur économique mise en valeur par sa galerie, de nature à procurer indûment un avantage à l’artiste française et la galerie la représentant.
En revanche, la juridiction d’appel a considéré que le seul fait de reprendre l’idée de thèmes de « fruits », « boxe », « portraits » ou « cœurs » ne saurait suffire à caractériser une volonté fautive de se placer dans le sillage du travail d’autrui, dès lors qu’il s’agit de thèmes du domaine public et qu’ils sont traités de manière propre par chacun des artistes.
A titre d’exemple, le thème du cœur associé à un message est universel et à cet égard l’usage du rouge, du noir et du blanc n’est pas l’apanage exclusif d’un artiste.
Cette décision confirme donc que l’appréciation de la contrefaçon d’œuvres d’art est effectuée de manière globale par les juges (en fonction des ressemblances et non des différences), et que la frontière entre contrefaçon et parasitisme demeure mince.